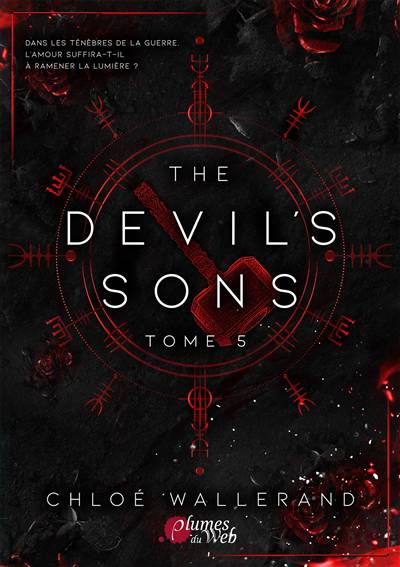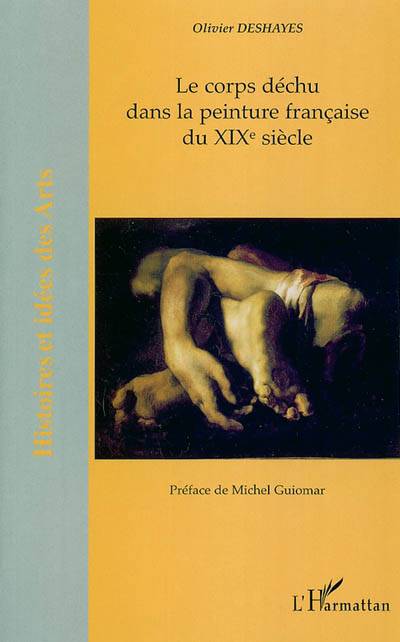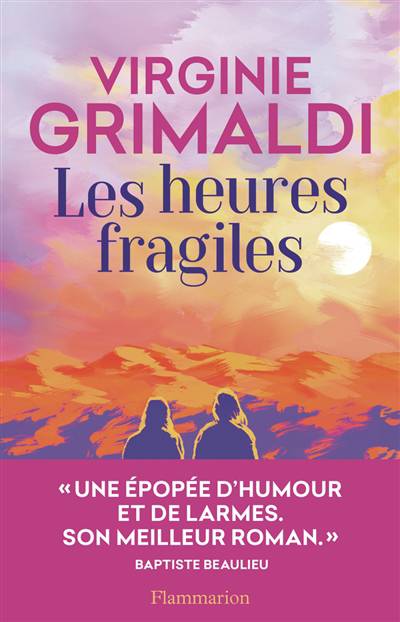
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Vouée à l'impossible, la peinture française ne pouvait
qu'abandonner les voies de l'idéalisation et s'affirmer,
durant le XIXe siècle, comme la consécration d'un formidable
fiasco, in fine. L'analyse du paradoxe promet d'être
féconde. Faut-il y voir plus généralement, comme je le
pense, une défaite à la source de la création ? Le défi relevé
dans ce livre est double. Sa visée est assurément celle d'une
faillite de l'entreprise créatrice, qui garantit son activité et
la reconduit sans cesse, prise dans le vertige d'une salutaire
répétition. Mais il s'exerce également par le biais de la
fragmentation du corps et de la peinture. Delacroix, Géricault,
Ingres par exemple feront valoir, chacun à sa façon,
de singuliers procédés de morcellement, propres à transformer
les destins du corps qu'ils n'auront de cesse de corrompre,
de bafouer et d'humilier. Telle fut l'expérience tragique
de l'humain.
C'est dire si la peinture française au XIXe siècle élabore
à son insu une esthétique subversive, préfigurant sans
conteste l'un des versants majeurs de notre modernité.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 270
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782747563420
- Date de parution :
- 15-04-04
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 305 g
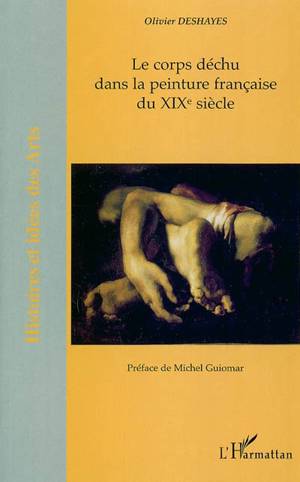
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.