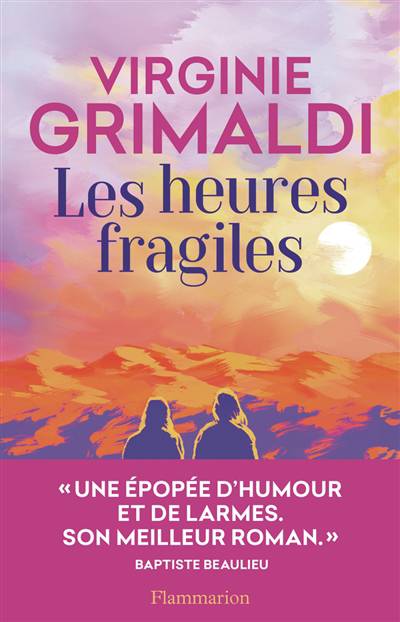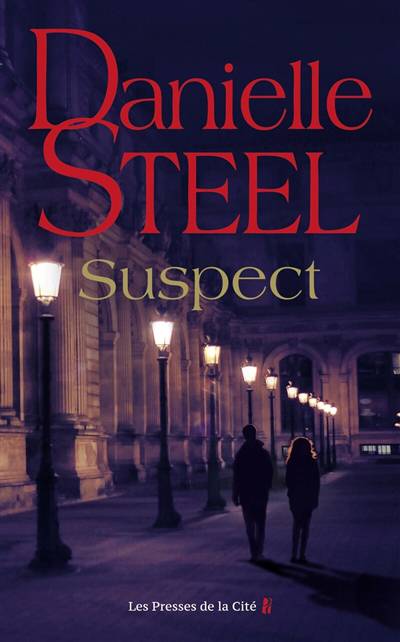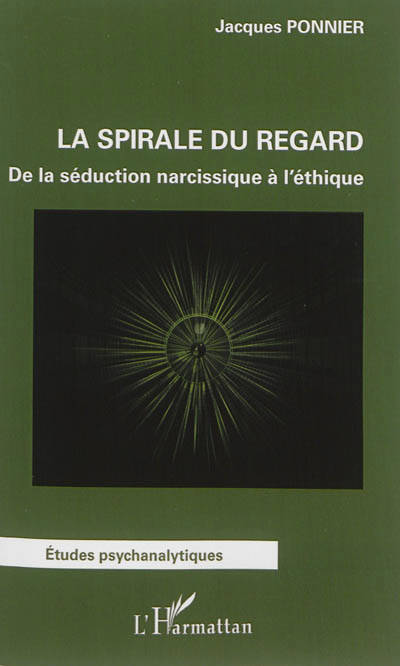- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
La spirale du regard
de la séduction narcissique à l'éthique
Jacques PonnierDescription
N'en déplaise aux lacaniens, les troubles auxquels le psychanalyste a,
aujourd'hui, affaire, sont des troubles narcissiques, des failles dans un
«moi» de plus en plus incertain et de moins en moins capable de trouver
la juste distance avec l'autre. Produit social ou révélation d'une condition,
cette crise du moi se vit comme flou identitaire angoissant ou, au contraire,
comme atonie dépressive désespérante. Le psychanalyste, pour éviter la
naïveté et la maladresse, doit comprendre ce phénomène.
Le présent ouvrage montre l'importance extrême du regard et de son
trajet dans la constitution du moi. La psychanalyse travaille sur des lieux
psychiques et des images mentales, et la parole n'est qu'un véhicule. La
philosophie, elle, conçoit le lien entre le visuel et la pensée : si le toucher
et l'audition inclinent vers la matière et l'effusion des corps, la vue est le
sens qui nous donne un monde organisé, nous renvoie l'image de notre
«soi» et suscite notre envol vers l'idée. Sans le regard, point d'organisation
psychique.
Observant le monde, ce regard découpe agressivement, mais également
unifie : c'est la vie qui veut se conserver, et le voyeurisme n'en est qu'une
forme. Mais le «moi» ne commence qu'avec l'«être-regardé» par l'idéal.
C'est la séduction narcissique, passivation qui n'est tolérable que reprise
activement en compte : trajet du «se faire voir» au «s'observer soi-même»,
dernière position sur la spirale, qui engage l'examen éthique de ses pensées
et de ses actes. Examen d'autant plus urgent que la postmodernité se flatte
d'avoir congédié tous les impératifs moraux pour les remplacer par la
niaiserie des bons sentiments et le calcul mesquin de l'intérêt personnel.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 235
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782343020990
- Date de parution :
- 10-12-13
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 290 g
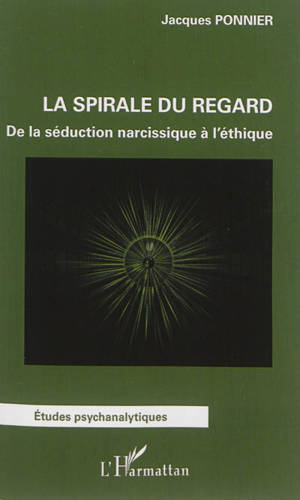
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.