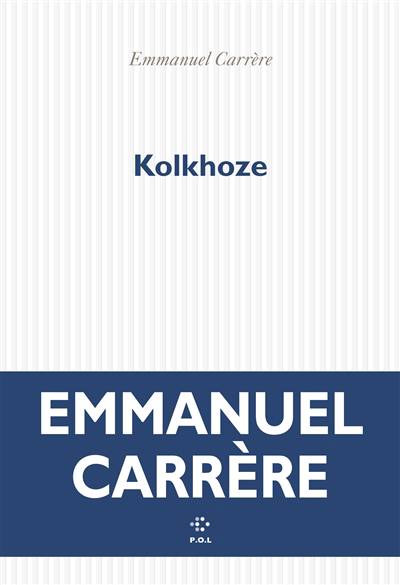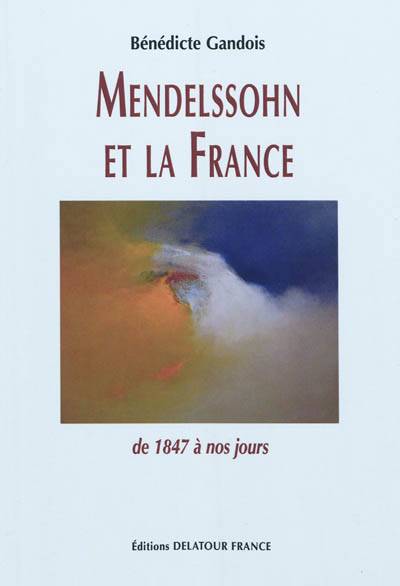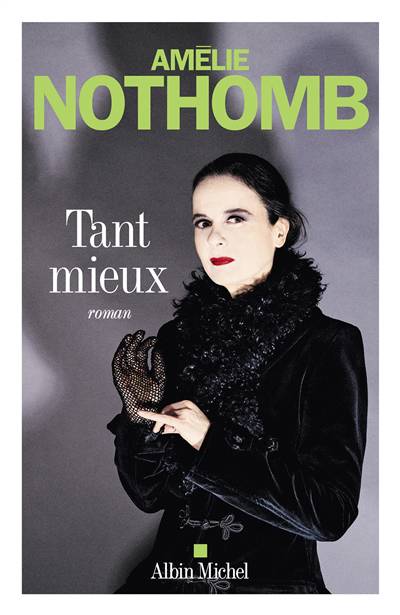
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Le musicologue ou le mélomane qui s'intéresse à Felix Mendelssohn
se trouve parfois désorienté : la plupart des dictionnaires et les rares
ouvrages en langue française consacrés à ce compositeur le citent
comme l'un des grands maîtres de l'école romantique, tout en rabaissant
aussitôt son rôle dans l'histoire de la musique, ou la valeur de son style,
quand on n'écrirait pas cela d'un Schumann, d'un Liszt ou d'un Weber.
On a dit de sa musique qu'elle était trop abondante, trop «facile»...
alors que l'on connaît le soin excessif qu'il portait à ses compositions et la
retenue qui le caractérisait. Paradoxalement, toute l'école symphonique
française de la fin du XIXe siècle s'inspire de Mendelssohn autant,
sinon plus, que de Beethoven ; pourtant, on considère ordinairement
le créateur de l'ouverture de concert détachée de toute musique de
scène comme un musicien «classique», jamais comme un novateur
ou un musicien d'avant-garde. Enfin, Mendelssohn fut de son vivant le
compositeur allemand le plus célèbre de son temps et son décès brutal
en 1847 donne lieu à des cérémonies et hommages dans toute l'Europe.
Cependant, moins de dix ans après sa mort, Mendelssohn n'est plus
qu'un «petit génie» (Liszt) à côté de l'immense Beethoven.
Cet ouvrage se propose d'embrasser ces paradoxes et d'étudier
comment a pu évoluer le regard des musiciens, du public et des critiques
français sur ce compositeur aux XIXe et XXe siècles.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 97
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782752100832
- Date de parution :
- 01-11-10
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 180 mm x 250 mm
- Poids :
- 300 g
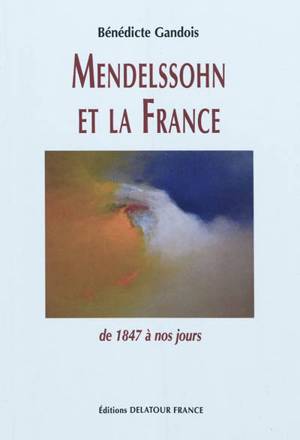
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.