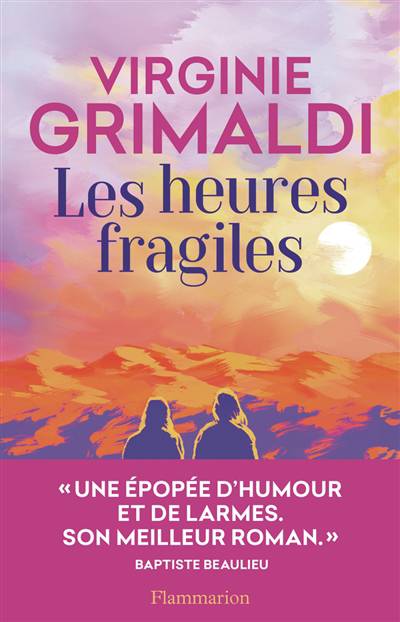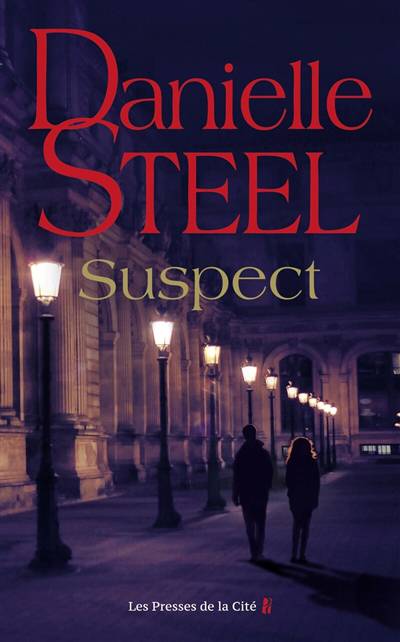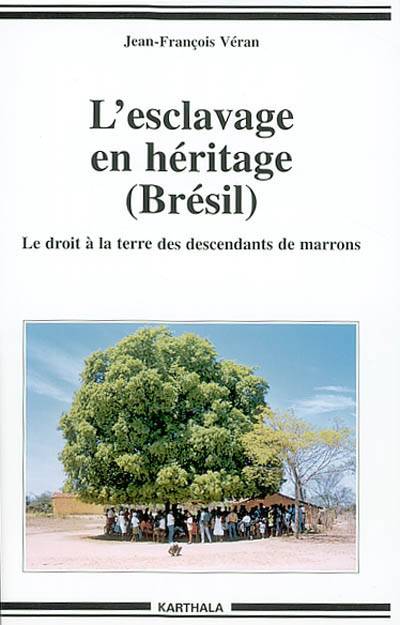- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
L'esclavage en héritage (Brésil)
le droit à la terre des descendants de marrons
Jean-François VéranDescription
La constitution brésilienne de 1988 prévoit que soient reconnues
et légalisées les terres des populations noires paysannes dont
les ancêtres étaient des esclaves fugitifs et vivaient en communautés
(communautés marrons, en brésilien quilombos). Votée dans le
contexte du premier centenaire de l'abolition de l'esclavage et
sous la pression des mouvements militants noirs, cette disposition
était surtout un gage symbolique de réconciliation nationale.
Dépourvue de tout cadre réglementaire, elle ne semblait d'ailleurs
pas applicable. Les quilombos n'étaient voués qu'à être d'improbables
lieux de mémoire.
Au début des années 1990, pourtant, des «communautés
noires» affirment être les héritières des anciens quilombos et,
invoquant la constitution, exigent les titres de propriété des terres
qu'elles occupent.
A l'interface entre «question agraire» et «question raciale»,
entre mémoire et ethnicité, au carrefour du terrain ethnographique
et de l'analyse sociologique, cet ouvrage propose de suivre
l'aventure au cours de laquelle l'une de ces communautés, Rio
das Rãs (littéralement «Rivière des Grenouilles») de l'État de
Bahia, fut amenée à puiser dans son passé les ressources pour
garantir sa survie dans le Brésil contemporain.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 386
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782845864139
- Date de parution :
- 22-07-03
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 550 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.