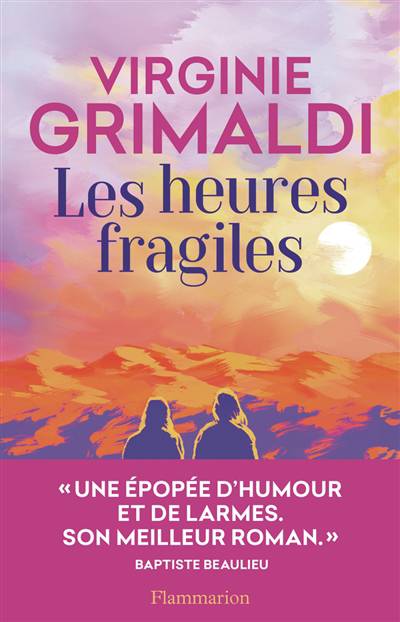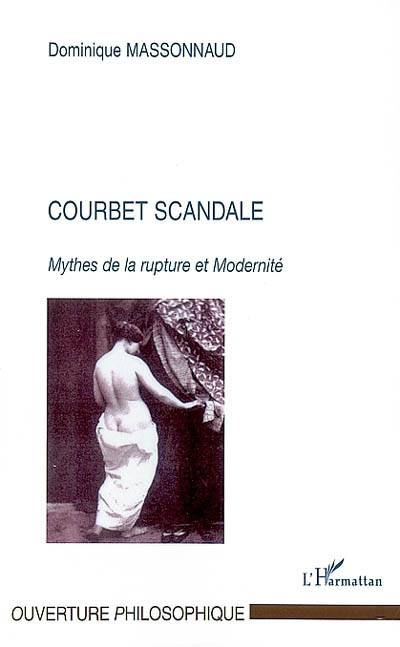- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
L'étude d'un objet particulier : le tableau-événement que
constitue La Baigneuse de Courbet en 1853, fait apparaître la
densité des enjeux souvent résorbés sous le terme de «scandale».
Le souci d'archive et la perspective d'analyse, «au plus
près» du tableau, font apparaître une part du conditionnement de
notre pensée critique et artistique, depuis le XIXe siècle. La référence
aux ruptures et aux actes de naissance relève d'un pouvoir
de la catégorie, qui permet au récepteur d'une oeuvre le repli vers
une rationalité. Elle épargne la difficulté de l'engagement, parfois
violent, parfois intime, dans une rencontre esthétique, où
prime la sensation. Les critiques, le public - et sans doute à certaines
heures, chacun d'entre nous - sont souvent avides de
mythes fondateurs, de reconstructions qui relèvent d'un esprit de
système, ancré dans l'origine même de la pensée rationnelle.
À partir de la Renaissance, la présence du spectateur impliquait
un regard spécifique, assigné : l'oeil du lecteur, sinon du
Prince. Notre position critique doit cependant faire droit à la
mise en cause plastique de ce système de valeurs, au milieu du
XIXe siècle. Le dérangement, la perturbation, suscités par le
tableau «moderne» engendrent une mise en cause sur le plan
épistémologique. Sortir de cette primauté du lisible sur le visible,
nous impose alors de perdre notre position de maîtrise. Quitte à
n'y rien voir, comme on l'a reproché aux commentateurs de
Courbet en 1853, il s'agit donc de prendre un risque : risquer
ainsi une méthode, qu'on pourrait appeler une «métanalyse».
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 298
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782747536820
- Date de parution :
- 03-03-03
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 360 g
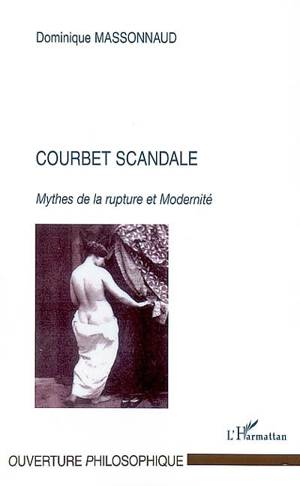
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.