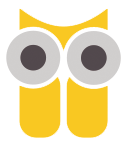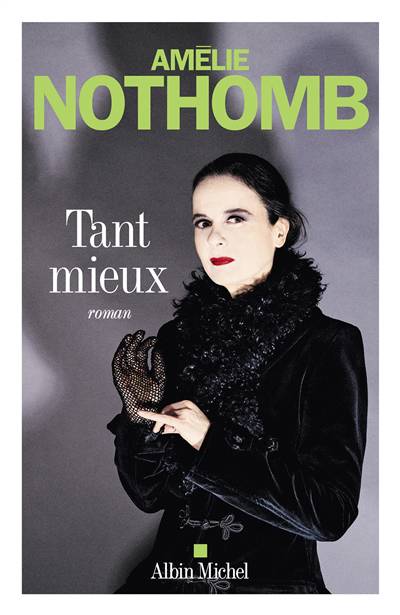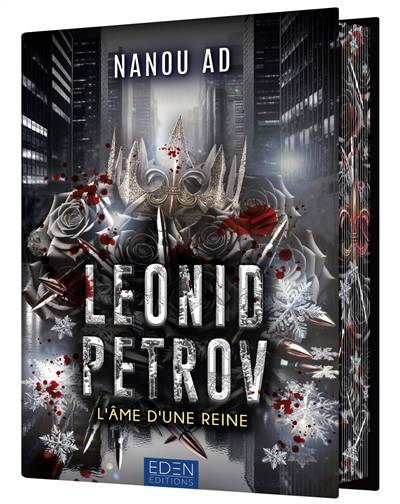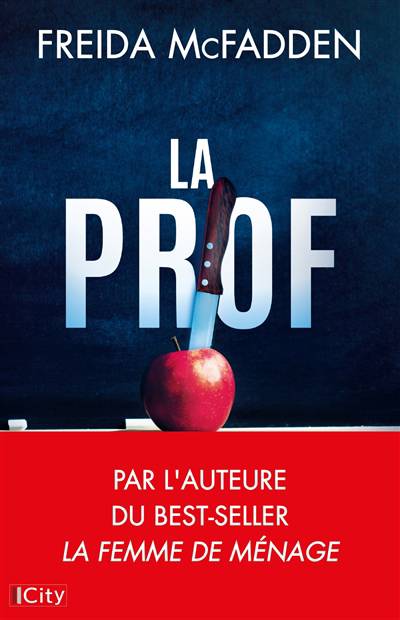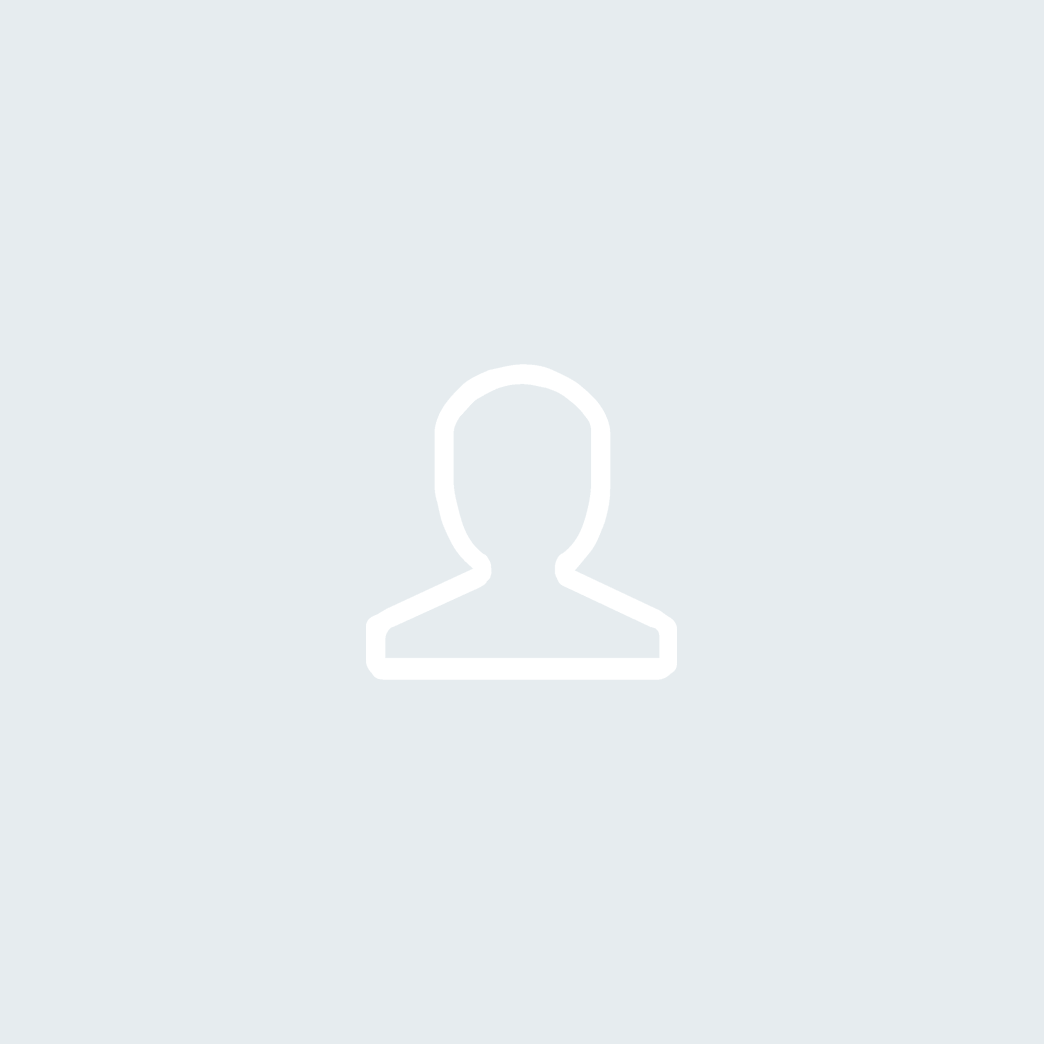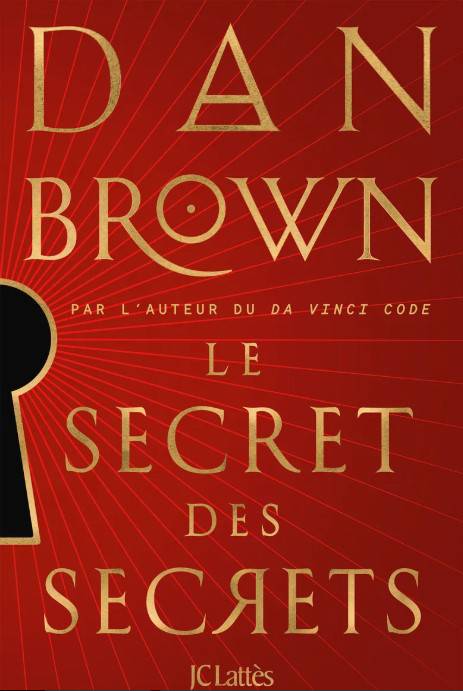
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Au mois de mai 1990, me trouvant à La Havane, j'ai
rendu visite à Dulce María Loynaz. Accompagné du
poète Manuel Díaz Martínez, j'ai poussé la grille de la légendaire
demeure. Une voix délicate, menue, a fait taire les
chiens pour nous permettre d'entrer. Bientôt, dans les multiples
pièces malmenées par l'humidité tropicale qui nous
entouraient, je vis tous ces objets qui intriguaient déjà Juan
Ramón Jiménez en 1937 : les tableaux, les bronzes, les porcelaines,
les éventails, les bibelots, les photos, les livres entassés
en piles instables. Assise devant nous dans un fauteuil
colonial, ses mains très fines posées sur sa longue jupe
grise, son visage très blanc sous la vague ondulante et soignée
de ses cheveux d'argent, la poétesse semblait attendre
patiemment les questions que nous ne cherchions pas à lui
poser ; ses yeux que l'on sentait menacés par la cécité derrière
les lunettes d'écaille - où était la chaînette d'or de Juan
Ramón Jiménez ? - nous observaient avec une malicieuse
sérénité ; le sourire était à la fois accueillant et aristocratiquement
triste. Devant notre silence, Dulce María nous parla
de ses projets : Un livre sur le quartier du Vedado où elle
avait toujours vécu, le Vedado avec son histoire, ses légendes,
ses traditions et ses coutumes. Quand elle évoquait ses
amis, ceux qui avaient vécu chez elle comme García Lorca
ou Gabriela Mistral, des sous-entendus discrets donnaient
un sel sceptique ou amusé à ses souvenirs. Avant de me
quitter, Dulce María alla chercher quelques précieuses éditions
originales qu'elle me dédicaça de son écriture haute et
penchée, d'un bleu marin, à laquelle l'âge n'avait rien enlevé
de sa fermeté.
Et je lui promis de traduire les poèmes qu'on lira
aujourd'hui.
Claude Couffon
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 127
- Langue:
- Français, Espagnol
Caractéristiques
- EAN:
- 9782914378437
- Date de parution :
- 16-10-03
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 210 mm
- Poids :
- 160 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.