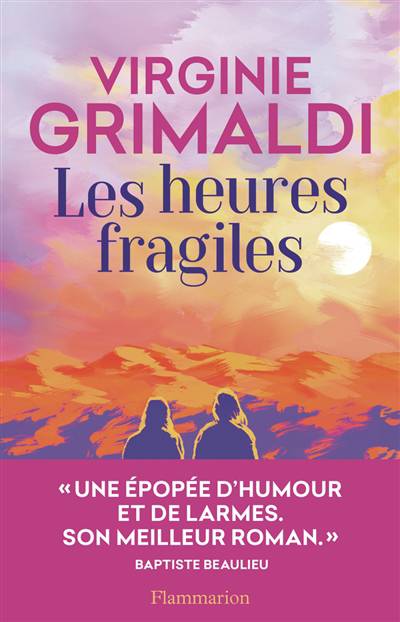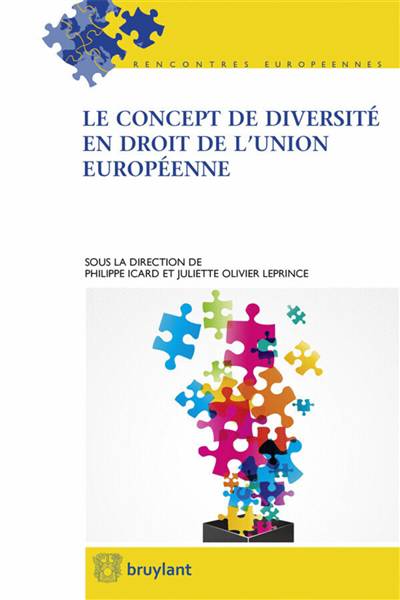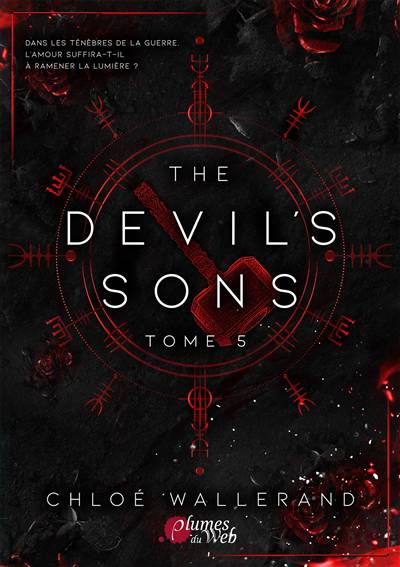
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
La diversité est «l'état, le caractère de ce qui est divers, varié, différent» affirme le dictionnaire
Larousse. Il s'agit, précise-t-il, de «l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par
leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle,
etc., et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent».
À travers sa devise «Unie dans la diversité», l'Union européenne en est une belle illustration.
Toutefois, contrairement à l'égalité, la diversité n'a pas de définition juridique. Le préambule
de la Charte des droits fondamentaux précise que «L'Union contribue à la préservation et au
développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures» et, selon
l'article 22, «L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique». Il revient donc à la
Cour de justice de l'Union européenne de clarifier cette notion.
Ainsi, l'Union européenne s'est donnée un cadre juridique qui protège «le multi-culturalisme de fait»
(interdiction de toute discrimination), sans toutefois oser définir ce qu'elle entend par diversité tant sur
le plan des pratiques culturelles que cultuelles. Le Traité de Lisbonne l'introduit en terme vague, dans
son préambule : «des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne
humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit...».
Certes, aussi bien la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour européenne des droits de
l'homme veillent à l'application des traités et du droit dérivé. Pourtant, dans tous les pays européens,
une montée de mouvements marqués par des sentiments d'intolérance et de crainte de la différence
se fait jour. Aussi, entre la revendication du «droit aux différences» susceptible d'aboutir «à la
différence des droits» et le repli sur une conception étriquée de l'Union européenne, il semble urgent
que l'Union européenne se dote d'un modèle favorisant cette unité des Européens dans toutes leurs
composantes.
Cet ouvrage se propose d'examiner comment le droit peut participer à cette construction d'un
consensus combinant à la fois toute cette diversité sans compromettre l'unité et l'originalité
européenne.
L'ouvrage s'adresse aux avocats spécialisés en droit de l'homme, en libre circulation des personnes et
en matière sociale, aux magistrats ainsi qu'aux universitaires.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782802751878
- Date de parution :
- 07-08-15
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 345 g
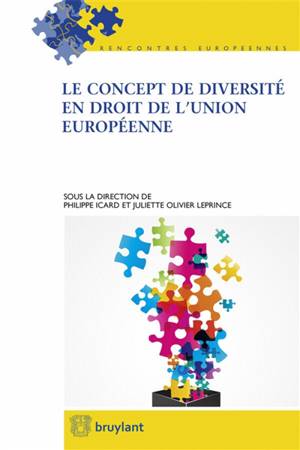
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.