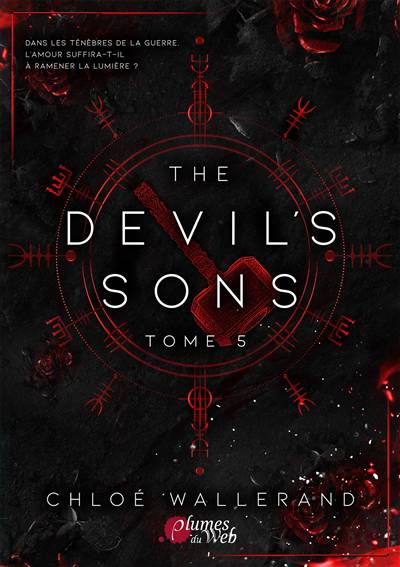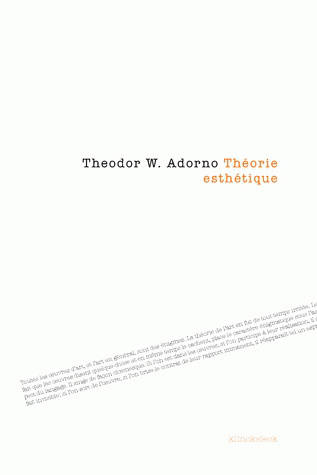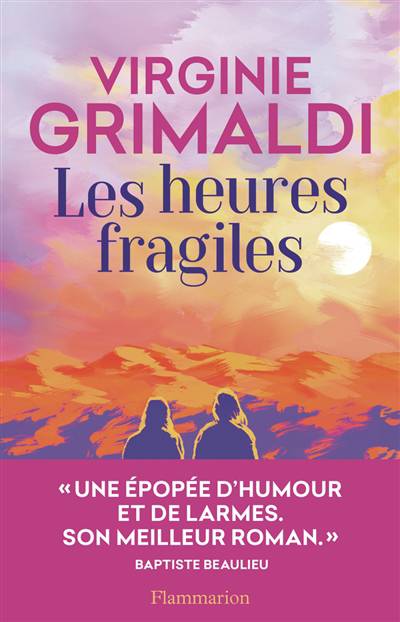
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Au siècle dernier, Theodor Adorno (1903-1969) s'impose
comme l'un des rares penseurs à oser prendre parti
en faveur de l'art moderne et des avant-gardes. Sans
attendre prudemment la consécration que le temps finit
parfois par accorder à des oeuvres résolument nouvelles,
le philosophe s'engage, dès 1923, dans les controverses
artistiques, notamment musicales et littéraires, de l'entredeux-guerres.
C'est ainsi qu'il défend âprement contre
ses détracteurs la nouvelle musique classique et les
compositeurs Alban Berg, Arnold Schönberg et Anton von
Webern. Il se fait l'avocat de James Joyce, de Paul Celan,
de Samuel Beckett à qui il dédie la Théorie esthétique.
Peu avant sa mort, en 1969, Adorno comprend, toutefois,
que sa théorie de la modernité est confrontée au déclin
de l'art moderne, à l'apparition de la postmodernité,
au triomphe du kitsch et à la suprématie de l'industrie
culturelle. Il craint que l'art lui-même ne survive dans
la société actuelle que sous la forme d'une culture docile,
entièrement soumise aux impératifs de la rentabilisation
marchande. Tel est bien, quarante ans après la mort du
philosophe, le défi majeur que doit relever une création
artistique préoccupée par la sauvegarde de son autonomie
et soucieuse de se définir encore comme espace de liberté.
Marc Jimenez
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Traducteur(s):
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 514
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782252037904
- Date de parution :
- 15-06-11
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 810 g
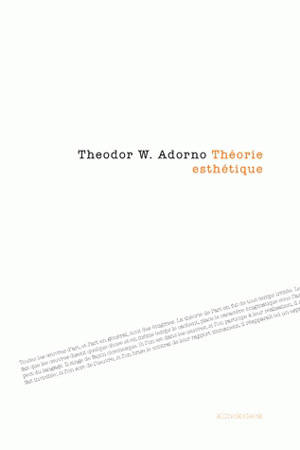
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.