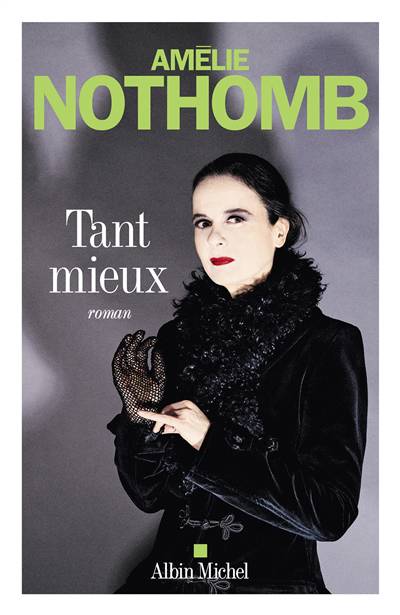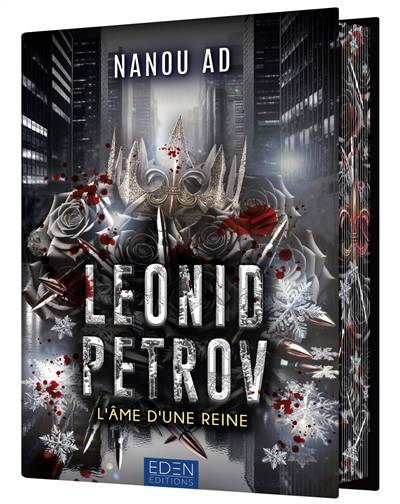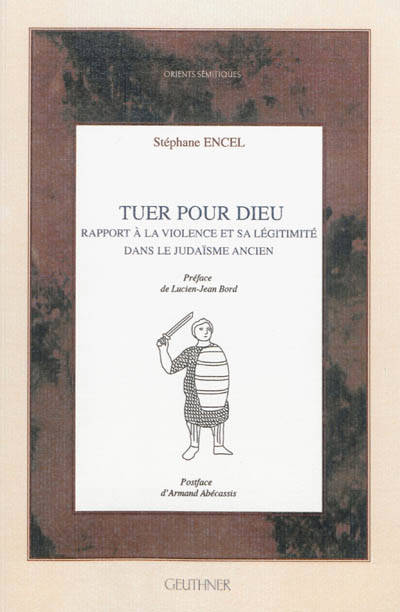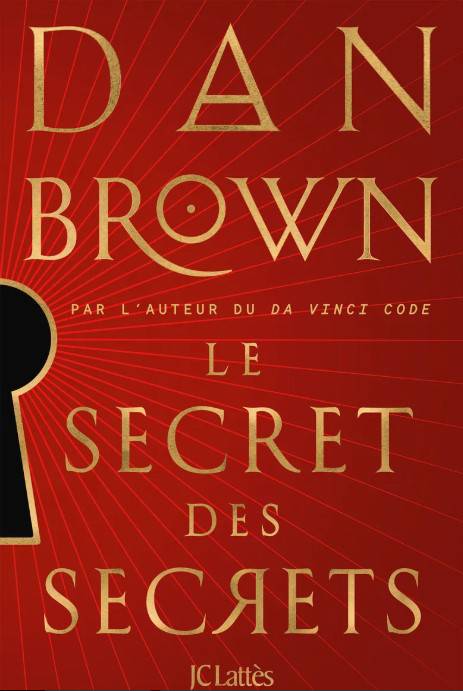
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Tuer pour Dieu
rapport à la violence et sa légitimité dans le judaïsme ancien
Stéphane EncelDescription
Le monothéisme conduirait-il ontologiquement à
la violence ? Serait-ce le zèle pour Dieu qui porterait la
potentialité de tuer en son nom ? Le judaïsme se
confronta très tôt à cette question d'une formidable
complexité : peut-on, et à quelles occasions, contrevenir
au sixième commandement et porter atteinte à son
prochain ? Moïse et Pinhas, Jérémie et les Maccabées,
les zélotes, Yohannan ben Zakkaï et Jésus ont eu
respectivement à estimer la situation de leur temps et
à délimiter des espaces de violence contenue, interdite ou
au contraire impérative. L'enjeu est considérable,
puisque la légitimité d'une telle violence est originée à la
source de la justice divine, et du nécessaire combat pour
sa défense ; à travers toute l'histoire du judaïsme ancien,
c'est l'une des controverses, majeure et existentielle,
clivant différentes interprétations internes des textes
sacrés, qui, toutes, se positionnent vis-à-vis d'un
contexte externe : religieux, politique ou géopolitique.
Une logique générale se dégage-t-elle de cette fresque
millénaire ? La violence comme son refus sont tous deux
des choix, et les hommes souhaitent chaque fois créer les
conditions de l'avènement du royaume de Dieu et de la
paix universelle. Ultimement, c'est le libre arbitre
du croyant qui est ainsi sollicité.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 342
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782705338725
- Date de parution :
- 26-11-13
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 600 g
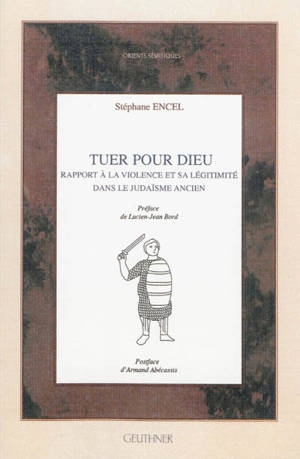
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.