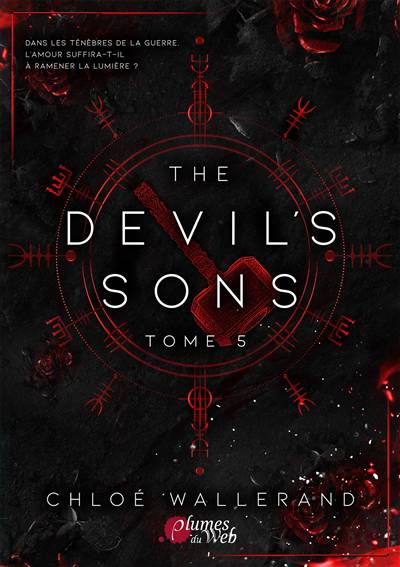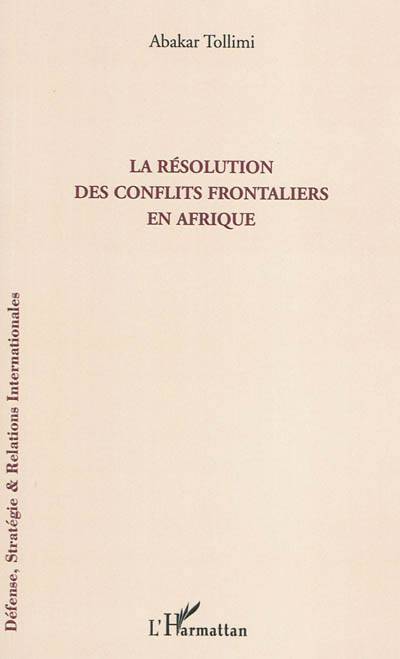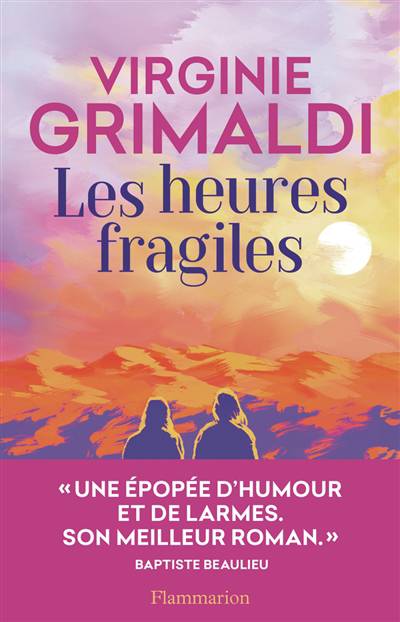
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Dans ce bel ouvrage de lecture facile et aisée, et tiré d'une
thèse de doctorat en droit présentée et soutenue avec brio à la
Sorbonne, l'auteur pose les jalons d'une pédagogie juridique
de la paix, et invite à penser le futur en termes de droit
préventif et de consolidation de la paix.
Davantage qu'une simple analyse des causes des conflits
africains qui sont nombreuses et bien connues (les questions
de nationalité et de citoyenneté, les questions de démocratie et
de l'État de droit, la question foncière, et les questions de
territoires et des frontières), l'auteur privilégie une étude
critique des instruments africains de règlement de conflits mis
en place par l'Organisation de l'Unité Africaine en 1993, et
met en lumière leurs limites intrinsèques et extrinsèques. Par
ailleurs, il analyse les procédures originellement africaines de
règlement des conflits pour leur éventuelle prise en compte
dans une perspective d'innovation normative. Mais, ces
procédures et instruments sont-ils (encore) adaptés pour être
utilisés dans la recherche des solutions à des crises actuelles ?
Peuvent-ils prévenir les conflits violents en attaquant leurs
causes profondes de manière ciblée ? Peut-on, dans le cas des
génocides et autres crimes contre l'humanité centrer la
démarche de pacification sur la restauration du lien social ou
sur la poursuite judiciaire des criminels ? Au vu de
l'expérience africaine et internationale, peut-on dire que la
force du droit est illusoire devant la force des armes ?
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 249
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782296124554
- Date de parution :
- 15-07-10
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 310 g
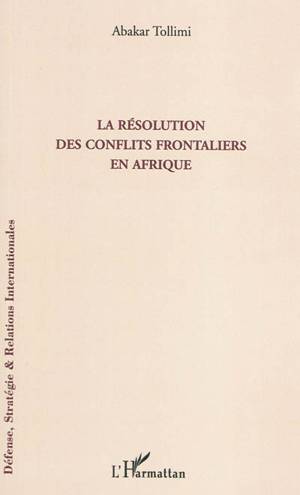
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.