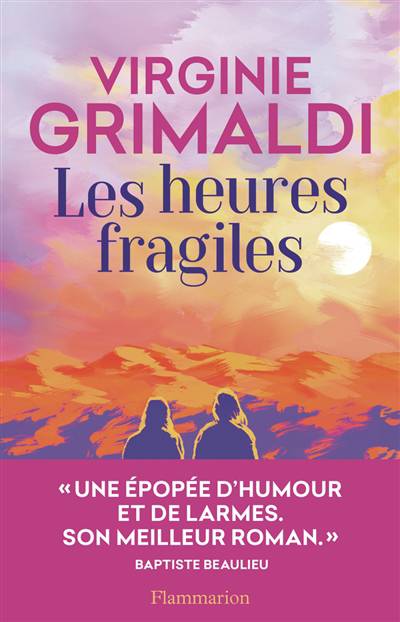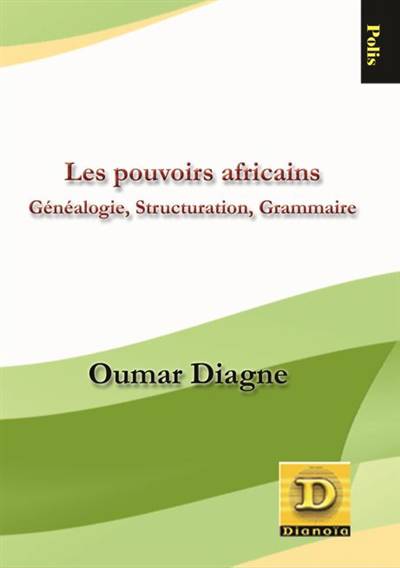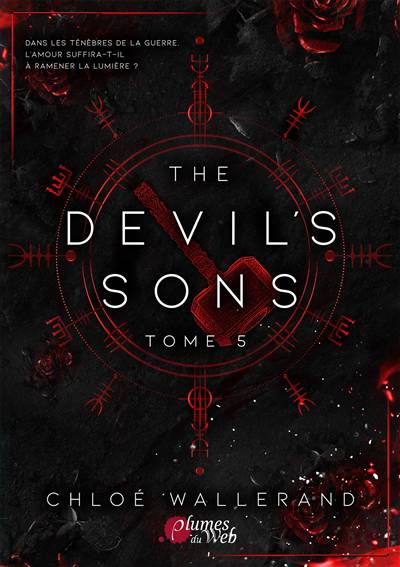
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Les pouvoirs africains
Généalogie, Structuration, Grammaire
Comment comprendre l'étrange fonctionnement des gouvernements africains qui se traduit par le fait que les dirigeants ont en général pour seul souci le monopole du pouvoir et rechignent à toute limitation de leurs prérogatives ? Quelles en sont les causes et comment éventuellement y remédier ? Tel est le problème ardu qu'affronte ce livre. Trois grandes classes d'explications sont proposées par l'auteur, (i) Ce sont des pouvoirs aliénés, toujours influencés par les anciennes puissances coloniales, et qui ne se maintiennent que comme suppôts de ces puissances étrangères. Pas étonnant donc qu'ils ne puissent servir leurs peuples, (ii) Il n'y a pas de contrôle collectif de ces pouvoirs. Les liens anciens des populations avec leurs dirigeants ont été altérés par la traite négrière, la colonisation, l'aventure néocoloniale ou postcoloniale et de nouveaux liens permettant un contrôle conséquent du pouvoir ont du mal à émerger. En toute logique, les dirigeants « africains » ont largement participé à freiner l'émergence de contre-pouvoirs. Les pratiques discriminatoires érigées en système de gestion de l'Etat ont accouché de nombreux conflits ethniques qui minent le continent, ce qui contraste d'avant la pénétration coloniale où l'Afrique connaissait l'existence d'ensembles politiques au sein desquels différentes « ethnies » cohabitaient pacifiquement. Si on ajoute la répression et le contrôle de l'opposition là où elle existe, on comprend comment s'est organisé le musèlement des sociétés, (iii) L'environnement mondial a un impact certain sur la structuration et les agissements des pouvoirs politiques et est un des éléments essentiels pour la compréhension de l'histoire politique africaine comme des modes de fonctionnement des pouvoirs. La fin de la guerre froide semble par exemple donner aux dirigeants africains plus d'autonomie.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 211
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782373691184
- Date de parution :
- 15-01-25
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 210 mm
- Poids :
- 253 g
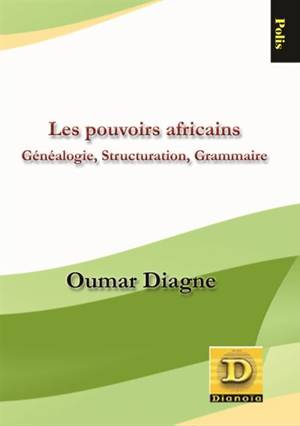
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.